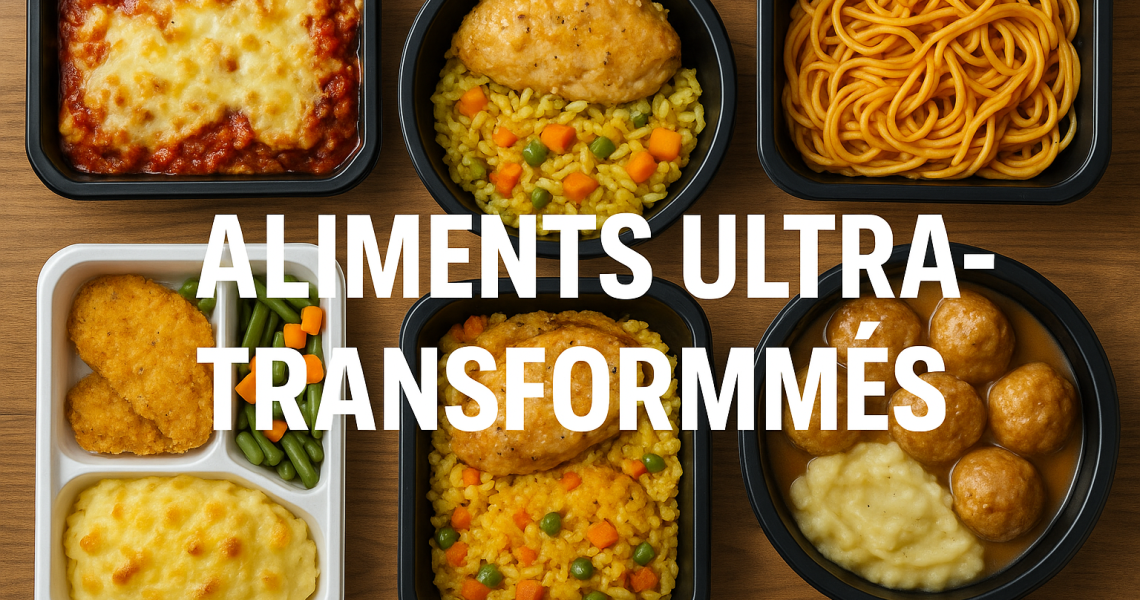Chaque jour, nous entendons que les « aliments ultra-transformés » sont responsables de nos maux : obésité, maladies cardiovasculaires, diabète… Mais si cette diabolisation était trop simpliste ? Dernièrement, une étude britannique de grande ampleur interroge cette vision dominante, en montrant que ce n’est peut-être pas tant le degré de transformation qui joue, mais plutôt nos perceptions, nos croyances et nos émotions. Dans cet article, vous allez découvrir :
- Ce que recouvre réellement la notion d’« ultra-transformé »
- Ce que suggère la recherche la plus récente
- Pourquoi nos représentations mentales peuvent peser plus lourd que la classification industrielle
- Les implications pour les politiques de santé publique
- Des pistes pragmatiques pour agir dans notre quotidien
Mon objectif ? Vous fournir une vision nuancée, rigoureuse, et actionnable — pas un slogan facile.
1. Que signifient vraiment les « aliments ultra-transformés » ?
La classification NOVA : utile mais contestée
Le système NOVA, souvent utilisé en nutrition publique, divise les aliments en quatre groupes selon leur degré de transformation industrielle. Le quatrième groupe regroupe les “ultra-transformés” : produits industriels riches en additifs, sucres, arômes, stabilisants… (boissons sucrées, barres chocolatées, plats cuisinés, etc.).
Mais cette catégorisation a ses limites :
- Elle mélange dans le même panier des produits très dissemblables (ex. boissons sucrées, substituts végétaux réformulés) ;
- Elle ne rend pas compte de la variabilité nutritionnelle à l’intérieur de cette catégorie ;
- Elle ne prend pas en compte l’attrait sensoriel, les habitudes culturelles, les contextes de consommation.
| `A lire aussi: Formation laser anti tabac et addiction. Mylasertabac |
Pourquoi cette catégorie est devenue un “ennemi public numéro 1”
Depuis plusieurs années, les discours médiatiques et politiques pointent les aliments ultra-transformés comme un moteur majeur de l’épidémie d’obésité, de maladies cardiovasculaires, voire de troubles cognitifs. Résultat : étiquetages d’alerte, restrictions publicitaires, taxes, interdictions de vente dans certaines zones — tout cela fondé sur l’hypothèse que « plus l’aliment est transformé, plus il est nocif ».
Mais la science évolue.
2. Nouvelle étude, nouvelles perspectives : ce que révèle la recherche britannique
Une équipe de chercheurs a examiné les réponses de plus de 3 000 adultes britanniques confrontés à 400 aliments représentés en photos. Leurs objectifs : mesurer l’“appréciation” des aliments (ce qu’ils jugent plaisant) et leur propension à la surconsommation hédonique (c’est-à-dire la consommation au-delà de la satiété).
Résultats marquants
- Le classement NOVA explique seulement 2 % des différences d’appréciation entre les aliments, et 4 % des comportements de surconsommation.
- En revanche, les attributs perceptuels (goût, texture, gras, sucré) et les croyances que les individus ont sur un aliment (par exemple « c’est industriel / naturel / artificiel / sain / calorique ») expliquent une part beaucoup plus importante.
- Lorsqu’un aliment est perçu comme “fortement transformé”, il est plus susceptible d’être consommé sans retenue, même si sa composition réelle ne le justifie pas.
- En combinant les données nutritionnelles (41 %) et les croyances / perceptions (37 %), les chercheurs arrivent à prédire 78 % des variations dans la propension à la surconsommation.
Ce que cela nous apprend
La classification industrielle seule (NOVA ou autre) ne suffit pas pour expliquer pourquoi nous consommons parfois “trop” un aliment. Nos représentations mentales — ce que nous croyons, ressentons, anticipons — jouent un rôle crucial.

3. Pourquoi nos croyances l’emportent souvent sur la classification
Le pouvoir des représentations
Quand un produit est étiqueté “ultra-transformé”, cela active des réactions en chaîne : jugements de culpabilité, de “malbouffe”, de danger. Même un produit nutritionnellement équivalent mais perçu comme « artisanal » ou « naturel » sera souvent mieux toléré — voire surconsommé avec moins de scrupules.
Le goût, la satiété, l’émotion
Deux mêmes aliments peuvent être jugés différemment selon l’environnement, le marketing, la présentation, ou même le moment de la journée. L’envie émotionnelle (réconfort, stress, convivialité) influence nos choix.
De surcroît, réformer un produit (réduire sucre, gras, sel) n’est pas toujours suffisant ; il faut accompagner cette reformulation d’une gestion du goût, de la satiété, et des attentes sensorimotrices.

4. Que faire des politiques nutritionnelles actuelles ?
Limites des approches “interdites / taxées / alertées”
- Elles risquent de diaboliser des aliments qui peuvent avoir leur place dans une alimentation équilibrée (ex. céréales enrichies, substituts protéinés).
- Elles peuvent semer la confusion pour le grand public, en donnant des signaux contradictoires (un produit transformé mais “saine option” ?).
- Elles ne traitent pas les dimensions psychologiques, sociales et culturelles des habitudes alimentaires.
Vers une nutrition plus intelligente et contextualisée
Les chercheurs suggèrent trois axes essentiels :
- Éducation nutritionnelle : apprendre aux gens non seulement à lire les étiquettes, mais à comprendre leurs signaux de faim, leurs envies, les contextes de consommation.
- Reformulation raisonnée : concevoir des produits plus rassasiants, moins hyper-appétants, tout en préservant le plaisir gustatif.
- Prise en compte des motivations alimentaires : reconnaître que manger est aussi un acte émotionnel, social et identitaire — pas seulement un besoin physiologique.
5. Au quotidien : comment agir ?
- Privilégier les aliments peu transformés, mais sans culpabilité excessive : un produit transformé peut trouver sa place.
- Cultiver la conscience de ses perceptions : questionner ce que vous ressentez en voyant « ultra-transformé ».
- Manger dans un contexte favorable : sans stress, sans distraction, avec modération consciente.
- Introduire de la variété, des textures, des plats faits maison quand c’est possible.
- Se méfier des “régimes simplistes” et de la punition psychologique qui accompagne parfois les injonctions alimentaires.
Conclusion:
Notre rapport à l’alimentation est plus complexe que la simple opposition “transformé / non transformé”. L’étude britannique démontre que nos croyances, nos sensations, nos représentations mentales interviennent massivement dans nos comportements.
Pour les politiques publiques comme pour nos choix quotidiens, l’enjeu est de passer d’une vision manichéenne à une approche plus nuancée, basée sur l’éducation, la compréhension psychologique, la réforme intelligente, et le respect du plaisir.